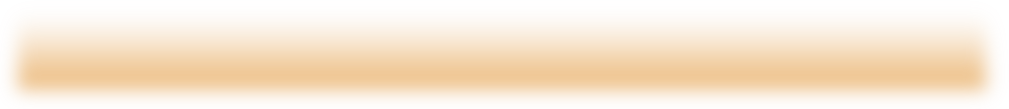Extrait d'un rapport émis par le médecin allemand du bataillon, médecin en chef, le Docteur Nagel
17 mai 1917
Cette nuit nous sommes arrivés en première ligne, à savoir le mont Cornillet, si disputé. Ce monticule de craie visible de loin, il avait vue sur notre camp dans les bois, les colonnes de fumée avaient toujours attiré notre attention et nous ne nous doutions point que nous devrions nous-mêmes être stationnés ici. Autrefois le mont fut bien garni de forêt, il n'y en a guère trace ; les troncs, les racines, tout a disparu dans des entonnoirs de craie. Depuis des semaines et des mois les français bombardent autour du mont et ne réussissent pas à le prendre.
Un quelconque prédécesseur, qui a dû longtemps résider ici, a construit un tunnel, une vraie mine. Trois galeries parallèles de presque cent mètres de long mènent horizontalement à l'intérieur de ce mont escarpé et ne sont pas revêtues de cadres de galeries mais de troncs d'arbre de la taille d'un homme. Un certain nombre de galeries transversales relient des galeries principales et il faut y avoir habité un certain temps avant de s'y reconnaître. Plus on est éloigné de l'entrée, plus la couche de craie qui couvre est épaisse. La garnison de la galerie a dû compter à peu près 600 hommes, 2 compagnies d'infanterie, 2 compagnie de mitrailleurs, la compagnie de pionniers du régiment et une compagnie de pionniers de la division, 2 états-majors du bataillon. Avec le médecin assistant Köbel j'assure le service médical. Une salle qui peut contenir environ 50 blessés, une salle pour les pansements et un dortoir ; tel est notre royaume, l'entrée est identifiable grâce à une couverture de laine pendante, sinon personne ne nous trouverait. Il y a une provision que l'on pense inépuisable de grandes bouteilles d'oxygène, un dispositif pour se soigner soi-même, matériel de pansement ; à vrai dire ici il s'agit d'une première ligne pour une attaque de grande envergure où on obtient de tout... même des poux... Après une passation de pouvoir accomplie, mon prédécesseur n'oublia pas de me prédire que sans doute j'en récupérerais aussi dans la galerie sanitaire, lui aussi en aurait fait de même. Etant donné que je suis spécialiste en la matière, j'ai tenu à distance jusqu'à contre-ordre ces choses importunes. J'ai libéré mon lit en fer du sac de paille et je dors sur le tissu métallique dénudé. C'est ainsi que je n'en aurais certainement pas.
18 mai
Dans notre galerie sanitaire la nuit dure 24 heures et la lampe à acétylène avec son odeur si plaisante brûle en permanence. Les hommes de la troupe dans les couloirs ont des bougies. Puisque la galerie est fortement occupée dans la journée et seule une faible garnison est postée en haut sur le mont, l'air est tellement vicié vers le soir que les lumières brûlent à peine. Lors de la nuit, la provision en oxygène se renouvelle, en particulier grâce à plusieurs bouches d'aération à travers desquelles nous pouvons également mesurer l'épaisseur de la craie qui nous protège : à côté de la galerie du commandant du bataillon ce sont 18 m de craie qui nous protègent.
Il est à peine question de dormir, pendant la nuit les blessés et les intoxiqués par le gaz arrivent, pendant la journée les commandants en chef du bataillon viennent, parlent et se reposent sur mon lit en fer, ce que je leur accorde volontiers. L'esprit de la troupe est formidable. Cette nuit est arrivé un père de famille avec une légère blessure au pied et lorsque j'ai voulu lui remettre en main propre son petit papier attestant son état de blessé il m'a demandé de rester et d'attendre sa guérison ici en première ligne.
C'est bigrement humide dans la craie profonde, sur les vêtements la poussière de la marche d'approche devient comme une carapace. Les cigarettes ne veulent plus brûler et dehors, le ciel est bleu, sans nuages, le vent est calme et c'est un jour d'été brûlant. Les hommes de la troupe qui se reposent de la garde nocturne profitent de la fraîcheur de la galerie. Enfin le réapprovisionnement en nourriture fonctionne à nouveau et aujourd'hui pour la première fois nous touchons des parts complètes comme elles ont été conçues à l'arrière. Dans les deux premières nuits la moitié est restée sur le chemin car les troupes de porteurs étaient poursuivis par le feu de l'ennemi.
19 mai
Plus le soleil monte aujourd'hui, moins c'est supportable. Les français semblent une fois de plus vouloir préparer une percée particulière en direction du mont ; peut-être se sont-ils aperçus qu'au Cornillet on a changé de troupes et qu'ils veulent essayer une nouvelle tentative. Ils insistent en tirant sur nos entrées de galeries aidés par de nombreux aviateurs, appui aérien dont nous disposons très peu quant à nous. Si nous demandons la protection de l'aviation, un seul avion arrive devant lequel ceux des ennemis s'enfuient car visiblement la lutte n'est pas leur tasse de thé. Très satisfait le nôtre se retire, au bout de cinq minutes ils sont à nouveau là et le réglage de leur tir se poursuit et ainsi cela continue toute la matinée. Petit à petit nous sommes fâchés contre le retrait à répétition de notre avion et exigeons une protection aérienne ininterrompue, car la "position Cornillet" est la clé de voûte du secteur. Le soir arrive et le réglage du tir est contraint et forcé de faire une pause nocturne. Et toujours et toujours, les tirs d'obus aboutissant tout près de nos entrées de galeries nous ont soufflés la lumière. Et nous n'avons pas reçu de protection aérienne ininterrompue.
20 mai
Maintenant, on semble vouloir nous donner du fil à retordre. Notre première ligne en haut sur le mont a passé une sale nuit. Le français nous a gâtés de grenades à gaz qui en ont eu quelques uns. L'un après l'autre ils arrivaient, légèrement blessés, gravement blessés, intoxiqués par le gaz et ma galerie sanitaire s'est remplie de façon inquiétante. Il y en a déjà environ une quarantaine ici, j'ai travaillé toute la nuit et ma réserve d'oxygène qui semblait être inépuisable a fondu lors du traitement des intoxiqués au gaz. Dans la nuit à venir, les réserves doivent être renouvelées, les patients doivent être évacués, ils doivent être soignés dans les hôpitaux militaires et doivent à nouveau avoir la liberté de mouvement. Les premiers soins sont possibles, mais soigner 40 blessés et malades plus de 24 heures n'est pas possible.
Dehors, le jour s'est installé, les tirs ont cessé et l'afflux des patients également. La troupe renforcée reste aujourd'hui en haut sur le mont. La responsabilité pèse lourd sur nos commandants. Alors que jusqu'ici ils s'étaient accordé quelques heures de repos la nuit, cette fois-ci, ils étaient constamment debout et s'il n'y avait rien à signaler de particulier, ils faisaient leur apparition chez moi, terriblement inquiets intérieurement ; mon commandant de bataillon trouvait dans mon lit de fer un coin de repos bienvenu pour une cigarette alors que pour son propre matelas il avait une aversion insurmontable.
25 mai
Maintenant, la grande tragédie touche à sa fin et avec horreur je prends à nouveau la plume. Un lieutenant de mon bataillon, quelques sous-officiers et équipes et moi, voilà tout ce qui en est sorti intact du tunnel. Le 20 mai, tôt à 7 heures du matin, après une pause dans les tirs de deux heures, les français commencèrent de façon systématique à nous bombarder à mort.
Pendant la pause dans les tirs, la plupart des hommes se sont enfoncés dans un sommeil bien mérité. Moi aussi j'avais cette intention, après avoir travaillé 60 heures d'affilé, les soins, l'installation etc. mes jambes ne voulaient plus me porter. Je venais enfin de déposer la liste des besoins auprès du commandant, quand vînt le premier coup terrible, toute la galerie trembla et tous les dormeurs se dressèrent tels que des fourmis effarouchées, vînt ensuite encore un coup plus terrible et la galerie des commandants avec sa couche de craie de 18 mètres fut enfoncée. Le Major Witterlin, le commandant du 1er bataillon, put encore atteindre la sortie à côté de laquelle il était assis tout en travaillant, le comte Rambaldi, mon commandant, était enfoui sous la terre et rien ne laissait prévoir si ou comment on pouvait encore le sortir, mais il vivait encore. Le Major Witterlin se dirigea vers ses compagnies, calma un peu les hommes de troupe de la galerie en état d'alerte et convoqua les officiers de son bataillon afin de discuter de la situation. Et quand ils furent tous côte à côte, un obus s'abattit à cet endroit faisant écrouler la galerie et la totalité du corps des officiers fut tuée et enterrée. Le même sort fut réservé à deux de nos entrées, coup sur coup et la destruction presque entière de la galerie fut l'œuvre de quelques minutes. Le premier bataillon qui était stationné dans la partie Est, fut totalement perdu ; l'entrée s'était écroulée sous les tirs, il en était de même avec les couloirs de liaison vers le couloir du milieu. Déterrer le Major Witterlin à partir du couloir du milieu aurait représenté un travail de trois jours. Ceux qui étaient dans la galerie succombèrent en quelques secondes à l'oxyde de carbone que les obus éclatants à cet endroit répandaient avec une grande pression. Ils subirent une mort douce, sans douleurs, sans se douter qu'ils dormaient pour l'éternité. Un seul, qui se trouvait près de la bouche d'aération, put s'évacuer vers le haut; lorsqu'il appela de cet endroit, en bas il régnait déjà un silence de mort et personne n'était en mesure de répondre.
Dans la partie Ouest, la situation n'était pas meilleure. Certes, l'entrée était détruite ; par ailleurs, on pouvait circuler dans la galerie mais à cause de l'oxyde de carbone, tous s'étaient endormis pour toujours. Le docteur-assistant Köbel et le lieutenant Dauer étaient là-bas, tous continuaient à dormir en paix mais on ne pouvait plus réveiller personne. A peine Kobel et Daller pouvaient-ils rentrer. Dauer fut pris soudainement de délires terribles, Köbel trouva encore le chemin vers la galerie sanitaire mais ne pouvait plus reconnaître l'entrée et lorsque à son appel j'accourrais, il s'écroula dans mes bras. Ils s'en sortirent indemnes.
Contrairement à la galerie du commandant, la grande galerie centrale était restée intacte et c'est ici que tout ceux qui vivaient encore étaient debout ou couchés. Les hommes de troupe dormaient à nouveau. Ceux qui restaient encore, comme officiers de mon bataillon s'affairaient dans une activité concentrée pour sauver ce qui était encore à sauver. L'oxyde de carbone sortait à partir des galeries transversales en notre direction et il fallait les boucher à l'aide de caisses et de couvertures tout en sacrifiant notre irremplaçable réserve d'eau. Les malades, intoxiqués par le gaz, furent transportés dans la galerie sanitaire, dans la mesure où ils donnaient encore signe de vie. Ils recevaient de l'oxygène, partout il s'agissait d'organiser et de prêter main forte.
Le travail qui exigea le plus grand sacrifice fut effectué dans la galerie du commandant afin de sauver le comte Rambaldi. Il vivait encore, un morceau de tôle ondulé s'était mis autour de son corps le protégeant ainsi et supportait une montagne de craie. Seules ses jambes étaient enfouies mais il était hors de question d'essayer de le tirer au risque de les lui arracher. Ainsi il fallut tout d'abord enlever les masses de craie. Il s'avéra rapidement que c'était là un travail de Sisyphe, aussitôt remplacé par un nouveau glissement de craie. Tant bien que mal nous pûmes consolider le haut. Plus les masses de pierre enlevées étaient dégagées dans la galerie, plus le sol s'élevait et bientôt on ne put garder qu'une position courbée. Dans cette situation, le fait de réunir toutes les forces pour consolider, étayer nous laissant exposé à un danger des plus élevés, fut un acte héroïque de sacrifice suprême. Trois pionniers et l'ordonnance du comte y réussirent tout particulièrement. Jamais je n'oublierai ces braves épuisés par leur travail en position couchée ou à genoux, avec leurs visages rouges et couvert de sueur, titubant en arrière, le regard vide et bredouillant à voix rauque "de l'eau" et après s'être abreuvés rapidement et avoir soufflé profondément recommençaient sans cesse. Finalement il fallut couper les bottes et les jambières de Rambaldi morceau par morceau et un seul put l'atteindre en position couchée dans un espace très restreint. Celui-ci avait besoin pour sa propre protection du soutien de son camarade qui la main dans la ceinture du pantalon, l'œil sans cesse tourné vers le haut, observait les masses de craie et au premier signe d'un glissement, le tirait en arrière. Et nous avons réussi à l'extraire ! Après 6 heures de travail acharné nous avons porté le comte dans la galerie sanitaire, sans conscience. Je n'en croyais pas mes yeux, les jambes n'étaient pas cassées ; aux pieds non plus il n'y avait rien de grave à constater. Une piqûre bien dosée de camphre, il revint tout de suite à lui et sut immédiatement qu'il était libéré, qu'il était dans la galerie sanitaire, qu'on l'emmena à l'hôpital militaire, qu'il rentra dans sa patrie. D'une manière très touchante, il nous exprima sa gratitude et plus d'un, qui dans les heures du réel danger ne montra aucun signe de faiblesse, avala sa salive et se mordit les lèvres pour ne pas pleurer. Je posai des attelles sur ses jambes et transféra Rambaldi sur une civière, il devrait être parmi les premiers à être porté sur le chemin du retour.
Entre temps, il était 2 heures de l'après-midi et la présence dans la galerie touchait à sa fin. Il était impensable de mettre en ligne des hommes de troupe encore vivants pour essayer une percée, même si l'officier qui comptait le plus d'années de service, le capitaine Süss (Inf.Re.124), dans sa raideur ne voulut pas comprendre, que lorsque depuis des heures la catastrophe annoncée par nous les médecins, s'avérait vraie. Malgré toutes les mesures de blocage, l'oxyde de carbone venait sans cesse dans notre direction et la mort avait embrassé également dans la galerie centrale tous les dormeurs. A quoi bon les 50 dispositifs de survie ! Ils furent vite distribués et utilisés. Je n'ai guère pensé à moi et lorsque petit à petit il m'en fallut un, mon sous-officier, toujours fidèle dans le domaine du sanitaire surgit en me disant: "Voilà, il y a en a un, le dernier, je l'ai caché pour Monsieur le médecin en chef !".
Ce n'était pas très gai dans la galerie sanitaire, l'oxygène commençait à manquer, les intoxiqués par le gaz de combat souffraient beaucoup, gémissaient, toussaient, se tortillaient dans tous les sens, rampaient à quatre pattes pour les supplier qu'on leur donne l'oxygène à effet calmant, c'était terrible de ne pouvoir "aider" que par le biais de la morphine. Lentement une fatigue lourde commença à m'envahir et je cherchais un coin pour dormir. Je ne pouvais pas me placer sur mes camarades morts, ça non, le cœur me l'interdisait. C'est ainsi que les allées et venues et l'horreur permirent que je reste éveillé et ceci me sauva ; celui qui s' endormait, était perdu.
Entre temps, il était 3 heures, il fallut prendre une décision, celui qui restait dans la galerie était, à coup sûr, perdu. A l'entrée de la galerie centrale seulement il y avait encore de l'air frais. Mais, y rester était une arme à double tranchant car le moindre calibre pouvait achever cet individu. Devant la galerie un feu de barrage terrible était en place et il en coûtait beaucoup pour quitter la galerie et s'exposer ainsi au feu roulant.
Celui qui sentait encore de la force dans ses jambes devait aller vers le haut, en première ligne ; la galerie devait être évacuée. Avec mon sous-officier responsable du secteur sanitaire je voulus transporter le comte vers un lieu plus sûr. A l'entrée, en voyant les explosions, il déclara qu'il ne voulait pas passer par là sur une civière et qu'il voulait rester dans la galerie. Nous retournâmes alors avec lui et lui firent nos adieux après que je lui eus demandé de venir avec nous une dernière fois sans succès.
Un petit nombre de soldats se retrouva le soir dans le même hôpital de campagne, tout à fait par hasard. J'avais erré encore longtemps après notre troupe de combat et arrivai le dernier, environ vers minuit, j'était déjà donné comme perdu par les autres. Avec plusieurs sous-officiers et soldats j'étais parmi les premiers à quitter la galerie et avais été considéré perdu par tout le monde. Ainsi la joie des retrouvailles fut immense. J'avais un lit, un vrai lit, mais je ne pouvais pas dormir. Le lendemain je demandai à retrouver notre troupe de combat ; le bruit y circulait déjà que j'étais déclaré manquant ou mort, car de tous les autres qui étaient rentrés, le soir même il y avait un message. Et comme je surgis soudainement des buissons devant mon fidèle ordonnance Harrer, il recula d'un pas comme si j'étais un fantôme.
17 mai 1917
Cette nuit nous sommes arrivés en première ligne, à savoir le mont Cornillet, si disputé. Ce monticule de craie visible de loin, il avait vue sur notre camp dans les bois, les colonnes de fumée avaient toujours attiré notre attention et nous ne nous doutions point que nous devrions nous-mêmes être stationnés ici. Autrefois le mont fut bien garni de forêt, il n'y en a guère trace ; les troncs, les racines, tout a disparu dans des entonnoirs de craie. Depuis des semaines et des mois les français bombardent autour du mont et ne réussissent pas à le prendre.
Un quelconque prédécesseur, qui a dû longtemps résider ici, a construit un tunnel, une vraie mine. Trois galeries parallèles de presque cent mètres de long mènent horizontalement à l'intérieur de ce mont escarpé et ne sont pas revêtues de cadres de galeries mais de troncs d'arbre de la taille d'un homme. Un certain nombre de galeries transversales relient des galeries principales et il faut y avoir habité un certain temps avant de s'y reconnaître. Plus on est éloigné de l'entrée, plus la couche de craie qui couvre est épaisse. La garnison de la galerie a dû compter à peu près 600 hommes, 2 compagnies d'infanterie, 2 compagnie de mitrailleurs, la compagnie de pionniers du régiment et une compagnie de pionniers de la division, 2 états-majors du bataillon. Avec le médecin assistant Köbel j'assure le service médical. Une salle qui peut contenir environ 50 blessés, une salle pour les pansements et un dortoir ; tel est notre royaume, l'entrée est identifiable grâce à une couverture de laine pendante, sinon personne ne nous trouverait. Il y a une provision que l'on pense inépuisable de grandes bouteilles d'oxygène, un dispositif pour se soigner soi-même, matériel de pansement ; à vrai dire ici il s'agit d'une première ligne pour une attaque de grande envergure où on obtient de tout... même des poux... Après une passation de pouvoir accomplie, mon prédécesseur n'oublia pas de me prédire que sans doute j'en récupérerais aussi dans la galerie sanitaire, lui aussi en aurait fait de même. Etant donné que je suis spécialiste en la matière, j'ai tenu à distance jusqu'à contre-ordre ces choses importunes. J'ai libéré mon lit en fer du sac de paille et je dors sur le tissu métallique dénudé. C'est ainsi que je n'en aurais certainement pas.
18 mai
Dans notre galerie sanitaire la nuit dure 24 heures et la lampe à acétylène avec son odeur si plaisante brûle en permanence. Les hommes de la troupe dans les couloirs ont des bougies. Puisque la galerie est fortement occupée dans la journée et seule une faible garnison est postée en haut sur le mont, l'air est tellement vicié vers le soir que les lumières brûlent à peine. Lors de la nuit, la provision en oxygène se renouvelle, en particulier grâce à plusieurs bouches d'aération à travers desquelles nous pouvons également mesurer l'épaisseur de la craie qui nous protège : à côté de la galerie du commandant du bataillon ce sont 18 m de craie qui nous protègent.
Il est à peine question de dormir, pendant la nuit les blessés et les intoxiqués par le gaz arrivent, pendant la journée les commandants en chef du bataillon viennent, parlent et se reposent sur mon lit en fer, ce que je leur accorde volontiers. L'esprit de la troupe est formidable. Cette nuit est arrivé un père de famille avec une légère blessure au pied et lorsque j'ai voulu lui remettre en main propre son petit papier attestant son état de blessé il m'a demandé de rester et d'attendre sa guérison ici en première ligne.
C'est bigrement humide dans la craie profonde, sur les vêtements la poussière de la marche d'approche devient comme une carapace. Les cigarettes ne veulent plus brûler et dehors, le ciel est bleu, sans nuages, le vent est calme et c'est un jour d'été brûlant. Les hommes de la troupe qui se reposent de la garde nocturne profitent de la fraîcheur de la galerie. Enfin le réapprovisionnement en nourriture fonctionne à nouveau et aujourd'hui pour la première fois nous touchons des parts complètes comme elles ont été conçues à l'arrière. Dans les deux premières nuits la moitié est restée sur le chemin car les troupes de porteurs étaient poursuivis par le feu de l'ennemi.
19 mai
Plus le soleil monte aujourd'hui, moins c'est supportable. Les français semblent une fois de plus vouloir préparer une percée particulière en direction du mont ; peut-être se sont-ils aperçus qu'au Cornillet on a changé de troupes et qu'ils veulent essayer une nouvelle tentative. Ils insistent en tirant sur nos entrées de galeries aidés par de nombreux aviateurs, appui aérien dont nous disposons très peu quant à nous. Si nous demandons la protection de l'aviation, un seul avion arrive devant lequel ceux des ennemis s'enfuient car visiblement la lutte n'est pas leur tasse de thé. Très satisfait le nôtre se retire, au bout de cinq minutes ils sont à nouveau là et le réglage de leur tir se poursuit et ainsi cela continue toute la matinée. Petit à petit nous sommes fâchés contre le retrait à répétition de notre avion et exigeons une protection aérienne ininterrompue, car la "position Cornillet" est la clé de voûte du secteur. Le soir arrive et le réglage du tir est contraint et forcé de faire une pause nocturne. Et toujours et toujours, les tirs d'obus aboutissant tout près de nos entrées de galeries nous ont soufflés la lumière. Et nous n'avons pas reçu de protection aérienne ininterrompue.
20 mai
Maintenant, on semble vouloir nous donner du fil à retordre. Notre première ligne en haut sur le mont a passé une sale nuit. Le français nous a gâtés de grenades à gaz qui en ont eu quelques uns. L'un après l'autre ils arrivaient, légèrement blessés, gravement blessés, intoxiqués par le gaz et ma galerie sanitaire s'est remplie de façon inquiétante. Il y en a déjà environ une quarantaine ici, j'ai travaillé toute la nuit et ma réserve d'oxygène qui semblait être inépuisable a fondu lors du traitement des intoxiqués au gaz. Dans la nuit à venir, les réserves doivent être renouvelées, les patients doivent être évacués, ils doivent être soignés dans les hôpitaux militaires et doivent à nouveau avoir la liberté de mouvement. Les premiers soins sont possibles, mais soigner 40 blessés et malades plus de 24 heures n'est pas possible.
Dehors, le jour s'est installé, les tirs ont cessé et l'afflux des patients également. La troupe renforcée reste aujourd'hui en haut sur le mont. La responsabilité pèse lourd sur nos commandants. Alors que jusqu'ici ils s'étaient accordé quelques heures de repos la nuit, cette fois-ci, ils étaient constamment debout et s'il n'y avait rien à signaler de particulier, ils faisaient leur apparition chez moi, terriblement inquiets intérieurement ; mon commandant de bataillon trouvait dans mon lit de fer un coin de repos bienvenu pour une cigarette alors que pour son propre matelas il avait une aversion insurmontable.
25 mai
Maintenant, la grande tragédie touche à sa fin et avec horreur je prends à nouveau la plume. Un lieutenant de mon bataillon, quelques sous-officiers et équipes et moi, voilà tout ce qui en est sorti intact du tunnel. Le 20 mai, tôt à 7 heures du matin, après une pause dans les tirs de deux heures, les français commencèrent de façon systématique à nous bombarder à mort.
Pendant la pause dans les tirs, la plupart des hommes se sont enfoncés dans un sommeil bien mérité. Moi aussi j'avais cette intention, après avoir travaillé 60 heures d'affilé, les soins, l'installation etc. mes jambes ne voulaient plus me porter. Je venais enfin de déposer la liste des besoins auprès du commandant, quand vînt le premier coup terrible, toute la galerie trembla et tous les dormeurs se dressèrent tels que des fourmis effarouchées, vînt ensuite encore un coup plus terrible et la galerie des commandants avec sa couche de craie de 18 mètres fut enfoncée. Le Major Witterlin, le commandant du 1er bataillon, put encore atteindre la sortie à côté de laquelle il était assis tout en travaillant, le comte Rambaldi, mon commandant, était enfoui sous la terre et rien ne laissait prévoir si ou comment on pouvait encore le sortir, mais il vivait encore. Le Major Witterlin se dirigea vers ses compagnies, calma un peu les hommes de troupe de la galerie en état d'alerte et convoqua les officiers de son bataillon afin de discuter de la situation. Et quand ils furent tous côte à côte, un obus s'abattit à cet endroit faisant écrouler la galerie et la totalité du corps des officiers fut tuée et enterrée. Le même sort fut réservé à deux de nos entrées, coup sur coup et la destruction presque entière de la galerie fut l'œuvre de quelques minutes. Le premier bataillon qui était stationné dans la partie Est, fut totalement perdu ; l'entrée s'était écroulée sous les tirs, il en était de même avec les couloirs de liaison vers le couloir du milieu. Déterrer le Major Witterlin à partir du couloir du milieu aurait représenté un travail de trois jours. Ceux qui étaient dans la galerie succombèrent en quelques secondes à l'oxyde de carbone que les obus éclatants à cet endroit répandaient avec une grande pression. Ils subirent une mort douce, sans douleurs, sans se douter qu'ils dormaient pour l'éternité. Un seul, qui se trouvait près de la bouche d'aération, put s'évacuer vers le haut; lorsqu'il appela de cet endroit, en bas il régnait déjà un silence de mort et personne n'était en mesure de répondre.
Dans la partie Ouest, la situation n'était pas meilleure. Certes, l'entrée était détruite ; par ailleurs, on pouvait circuler dans la galerie mais à cause de l'oxyde de carbone, tous s'étaient endormis pour toujours. Le docteur-assistant Köbel et le lieutenant Dauer étaient là-bas, tous continuaient à dormir en paix mais on ne pouvait plus réveiller personne. A peine Kobel et Daller pouvaient-ils rentrer. Dauer fut pris soudainement de délires terribles, Köbel trouva encore le chemin vers la galerie sanitaire mais ne pouvait plus reconnaître l'entrée et lorsque à son appel j'accourrais, il s'écroula dans mes bras. Ils s'en sortirent indemnes.
Contrairement à la galerie du commandant, la grande galerie centrale était restée intacte et c'est ici que tout ceux qui vivaient encore étaient debout ou couchés. Les hommes de troupe dormaient à nouveau. Ceux qui restaient encore, comme officiers de mon bataillon s'affairaient dans une activité concentrée pour sauver ce qui était encore à sauver. L'oxyde de carbone sortait à partir des galeries transversales en notre direction et il fallait les boucher à l'aide de caisses et de couvertures tout en sacrifiant notre irremplaçable réserve d'eau. Les malades, intoxiqués par le gaz, furent transportés dans la galerie sanitaire, dans la mesure où ils donnaient encore signe de vie. Ils recevaient de l'oxygène, partout il s'agissait d'organiser et de prêter main forte.
Le travail qui exigea le plus grand sacrifice fut effectué dans la galerie du commandant afin de sauver le comte Rambaldi. Il vivait encore, un morceau de tôle ondulé s'était mis autour de son corps le protégeant ainsi et supportait une montagne de craie. Seules ses jambes étaient enfouies mais il était hors de question d'essayer de le tirer au risque de les lui arracher. Ainsi il fallut tout d'abord enlever les masses de craie. Il s'avéra rapidement que c'était là un travail de Sisyphe, aussitôt remplacé par un nouveau glissement de craie. Tant bien que mal nous pûmes consolider le haut. Plus les masses de pierre enlevées étaient dégagées dans la galerie, plus le sol s'élevait et bientôt on ne put garder qu'une position courbée. Dans cette situation, le fait de réunir toutes les forces pour consolider, étayer nous laissant exposé à un danger des plus élevés, fut un acte héroïque de sacrifice suprême. Trois pionniers et l'ordonnance du comte y réussirent tout particulièrement. Jamais je n'oublierai ces braves épuisés par leur travail en position couchée ou à genoux, avec leurs visages rouges et couvert de sueur, titubant en arrière, le regard vide et bredouillant à voix rauque "de l'eau" et après s'être abreuvés rapidement et avoir soufflé profondément recommençaient sans cesse. Finalement il fallut couper les bottes et les jambières de Rambaldi morceau par morceau et un seul put l'atteindre en position couchée dans un espace très restreint. Celui-ci avait besoin pour sa propre protection du soutien de son camarade qui la main dans la ceinture du pantalon, l'œil sans cesse tourné vers le haut, observait les masses de craie et au premier signe d'un glissement, le tirait en arrière. Et nous avons réussi à l'extraire ! Après 6 heures de travail acharné nous avons porté le comte dans la galerie sanitaire, sans conscience. Je n'en croyais pas mes yeux, les jambes n'étaient pas cassées ; aux pieds non plus il n'y avait rien de grave à constater. Une piqûre bien dosée de camphre, il revint tout de suite à lui et sut immédiatement qu'il était libéré, qu'il était dans la galerie sanitaire, qu'on l'emmena à l'hôpital militaire, qu'il rentra dans sa patrie. D'une manière très touchante, il nous exprima sa gratitude et plus d'un, qui dans les heures du réel danger ne montra aucun signe de faiblesse, avala sa salive et se mordit les lèvres pour ne pas pleurer. Je posai des attelles sur ses jambes et transféra Rambaldi sur une civière, il devrait être parmi les premiers à être porté sur le chemin du retour.
Entre temps, il était 2 heures de l'après-midi et la présence dans la galerie touchait à sa fin. Il était impensable de mettre en ligne des hommes de troupe encore vivants pour essayer une percée, même si l'officier qui comptait le plus d'années de service, le capitaine Süss (Inf.Re.124), dans sa raideur ne voulut pas comprendre, que lorsque depuis des heures la catastrophe annoncée par nous les médecins, s'avérait vraie. Malgré toutes les mesures de blocage, l'oxyde de carbone venait sans cesse dans notre direction et la mort avait embrassé également dans la galerie centrale tous les dormeurs. A quoi bon les 50 dispositifs de survie ! Ils furent vite distribués et utilisés. Je n'ai guère pensé à moi et lorsque petit à petit il m'en fallut un, mon sous-officier, toujours fidèle dans le domaine du sanitaire surgit en me disant: "Voilà, il y a en a un, le dernier, je l'ai caché pour Monsieur le médecin en chef !".
Ce n'était pas très gai dans la galerie sanitaire, l'oxygène commençait à manquer, les intoxiqués par le gaz de combat souffraient beaucoup, gémissaient, toussaient, se tortillaient dans tous les sens, rampaient à quatre pattes pour les supplier qu'on leur donne l'oxygène à effet calmant, c'était terrible de ne pouvoir "aider" que par le biais de la morphine. Lentement une fatigue lourde commença à m'envahir et je cherchais un coin pour dormir. Je ne pouvais pas me placer sur mes camarades morts, ça non, le cœur me l'interdisait. C'est ainsi que les allées et venues et l'horreur permirent que je reste éveillé et ceci me sauva ; celui qui s' endormait, était perdu.
Entre temps, il était 3 heures, il fallut prendre une décision, celui qui restait dans la galerie était, à coup sûr, perdu. A l'entrée de la galerie centrale seulement il y avait encore de l'air frais. Mais, y rester était une arme à double tranchant car le moindre calibre pouvait achever cet individu. Devant la galerie un feu de barrage terrible était en place et il en coûtait beaucoup pour quitter la galerie et s'exposer ainsi au feu roulant.
Celui qui sentait encore de la force dans ses jambes devait aller vers le haut, en première ligne ; la galerie devait être évacuée. Avec mon sous-officier responsable du secteur sanitaire je voulus transporter le comte vers un lieu plus sûr. A l'entrée, en voyant les explosions, il déclara qu'il ne voulait pas passer par là sur une civière et qu'il voulait rester dans la galerie. Nous retournâmes alors avec lui et lui firent nos adieux après que je lui eus demandé de venir avec nous une dernière fois sans succès.
Un petit nombre de soldats se retrouva le soir dans le même hôpital de campagne, tout à fait par hasard. J'avais erré encore longtemps après notre troupe de combat et arrivai le dernier, environ vers minuit, j'était déjà donné comme perdu par les autres. Avec plusieurs sous-officiers et soldats j'étais parmi les premiers à quitter la galerie et avais été considéré perdu par tout le monde. Ainsi la joie des retrouvailles fut immense. J'avais un lit, un vrai lit, mais je ne pouvais pas dormir. Le lendemain je demandai à retrouver notre troupe de combat ; le bruit y circulait déjà que j'étais déclaré manquant ou mort, car de tous les autres qui étaient rentrés, le soir même il y avait un message. Et comme je surgis soudainement des buissons devant mon fidèle ordonnance Harrer, il recula d'un pas comme si j'étais un fantôme.
 Retour
Retour